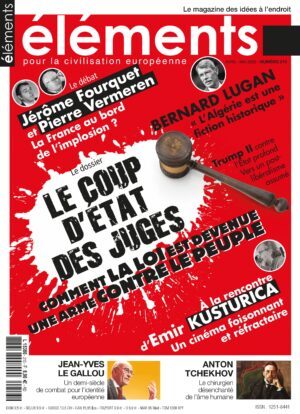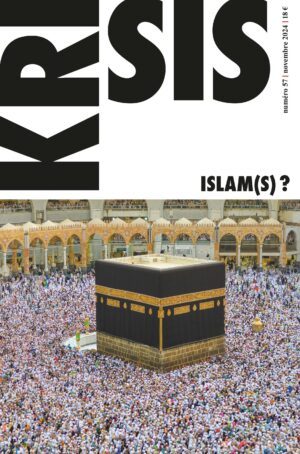Savoir si l’Ukraine allait un jour adhérer à l’Union Européenne a longtemps été un sujet de conversation pour dîners de diplomates. Les plus audacieux allaient jusqu’à évoquer une adhésion de la partie occidentale du pays après une partition à l’amiable, comme en Tchécoslovaquie. A la fin, tout le monde tombait d’accord pour dire que de toutes façons c’était une perspective bien lointaine. Là était l’essentiel : on pouvait encore longtemps esquiver la question de la zone légitime d’expansion de l’Europe, c’est-à-dire de sa frontière orientale, c’est-à-dire de son contact avec une zone d’influence russe. Pendant ce temps, élargissement après élargissement, l’OTAN suivie de l’UE progressaient tranquillement vers l’est malgré l’irritation croissante manifestée par la Russie. L’idée, avancée par François Mitterrand en 1991, de réunir une conférence internationale pour construire avec la Russie une architecture de sécurité en Europe de l’est, était oubliée depuis longtemps.
Quand, le 24 février 2021 l’armée russe a pénétré en territoire ukrainien, il était trop tard. Il n’y avait plus qu’à manifester notre sympathie à l’Ukraine en lui fournissant les moyens de tenir bon, avec l’espoir que la guerre ne durerait pas trop longtemps. Elle a duré et, peu à peu, on a vu émerger en Europe une doctrine nouvelle, non pas celle, qui s’était faite attendre en vain, d’une cohabitation avec la Russie, mais d’une menace russe sur l’Europe : l’attaque contre l’Ukraine serait la première étape d’un projet de soumission de l’Europe par la Russie.
La répétition ad nauseam d’une thèse, par l’autorité et par la grande presse, peut finir par lui donner des allures de vérité incontestable. La dernière en date, parce qu’elle induit une logique de guerre, mérite tout particulièrement un examen approfondi.
Ce discours performatif de « la menace russe » invoque l’Europe au singulier. Mais, face à la Russie, cette dernière n’est homogène ni par la géographie, ni par l’histoire.
Quelle Europe ?
Ainsi, les trois pays baltes où vivent de fortes minorités russophones, ont été intégrés dans l’UE et dans l’OTAN sans que soit stabilisé un modus vivendi avec la Russie de ces pays [1] et sans considération du lourd contentieux mémoriel qui les oppose : là comme en Ukraine, un fort courant d’opinion ne se résigne pas à voir dans les combattants nationalistes de la seconde guerre mondiale de simples collaborateurs du nazisme. Dans son roman historique Purge [2], la finno-estonienne Sofi Oksanen ne laisse aucun doute : pour elle, les bons sont la guérilla nationaliste soutenue par les Allemands, et les méchants, les occupants bolcheviques/russes.
La Suède, la Pologne se sont, quant à eux, battus dès le XVIIe siècle avec la Russie pour le contrôle de la zone des confins entre empire germanique et empire russe. Une grande partie de cette zone constitue aujourd’hui l’Ukraine (mot signifiant « les confins » en russe), Etat établi par étapes au XXe siècle autour d’une nation ukrainienne cristallisée au XIXe siècle, comme d’autres nationalités d’Europe centrale et orientale.
La Pologne, qui a payé de 6 millions de morts la guerre avec l’Allemagne, ne lui en garde guère de rancune. Elle réserve sa haine à la Russie, à laquelle elle doit un demi-siècle d’un régime qui, pour n’avoir pas été le plus brutal du bloc soviétique, n’en fut pas moins détesté. Auparavant il y avait eu les guerres du XVIIe siècle, qui avaient conduit l’armée polonaise à occuper Moscou (1610), au partage de la Pologne, à la répression du mouvement national polonais au XIXe siècle (« L’ordre règne à Varsovie »), à la guerre de 1920 qui avait conduit l’armée rouge jusqu’aux portes de Varsovie, puis l’agression germano-soviétique de 1939, et enfin les insurgés de Varsovie abandonnés à leur sort en janvier 1945. L’héritage est lourd, et il a un arrière-plan religieux.
L’Allemagne est sortie de l’histoire en 1945, devenant une fidèle vassale de l’Amérique. A partir de 1970, elle s’est dotée d’une stratégie de coopération économique à l’est qui a été, par ses délocalisations industrielles en Europe orientale et par son accès à l’énergie russe bon marché, une des clefs de sa prospérité. Elle ne subit aucune menace de la Russie, tandis que 45 ans d’appartenance de la RDA au bloc soviétique et un demi-siècle de coopérations intenses avec l’Europe orientale lui ont sans doute donné un sentiment d’identité est-européenne [3]. Elle se réveille de son sommeil stratégique au son des discours bellicistes, et annonce un formidable effort de réarmement pour faire face à la « menace russe ». Vraiment ? Le face à face du monde germanique et de l’empire russe est une réalité géographique et historique pluriséculaire. Mais l’Allemagne c’est avant tout le grand pays du centre de l’Europe, avec tout ce que cette situation peut engendrer de pressions, de frustrations, parfois de paranoïa et de mégalomanie. Un des effets les moins discutables de la Pax americana en Europe est que les pays européens, ayant confié leur défense aux États-Unis, ont réduit leurs armées à un niveau ne leur permettant plus de se faire la guerre entre eux. Le réarmement est maintenant engagé, ou du moins décidé. Mais quand les illusions de « la défense européenne » se seront dissipées, quand le retour du protectionnisme engendrera de nouvelles rivalités économiques qui fragiliseront l’UE, et quand l’effort d’armement aura fait sentir ses effets sur l’Etat-providence garant de la paix sociale, il n’est pas du tout certain que ces nouveaux arsenaux serviront uniquement à « contenir la menace russe ». Il faut avoir la mémoire bien courte pour se féliciter du réarmement de l’Allemagne et l’encourager comme le font nos dirigeants.
A l’ouest de l’Allemagne, personne n’a de contentieux avec la Russie et personne ne subit de menace russe. Les plaintes de la France d’avoir été expulsée de son pré carré africain par la Russie ne sont pas fondées, elle l’a perdu toute seule [4] et la nature a horreur du vide. Les menées pernicieuses des hackers russes sur internet sont certainement réelles. Mais pourquoi s’étonner de mauvais procédés de la Russie, quand nous envoyons des armes en Ukraine pour pilonner ses troupes et son territoire ? Pour des raisons que nous jugeons excellentes, nous adoptons une attitude hostile à la Russie – il n’y a donc pas lieu de s’indigner de la voir répondre, jusqu’à présent par des moyens infra-militaires.
Le prolongement de la guerre froide
Mais « la menace russe » ne concernerait pas seulement tel ou tel pays européen, elle viserait, pour des raisons qu’on a du mal à discerner au-delà de son évidente allégeance à l’empire américain, le projet de la construction européenne. L’hostilité de la Russie envers l’Union Européenne est en effet aujourd’hui affirmée. On peut chercher à l’expliquer par de noirs desseins de l’ours russe, mais on peut aussi se contenter d’observer qu’après l’effondrement de l’URSS, l’UE a conservé son logiciel de la guerre froide, et que, depuis la guerre d’Ukraine, quelles que soient les habiletés discursives, elle traite la Russie en pays ennemi et arme son adversaire.
En résumé, les pays baltes ont un vrai contentieux avec la Russie et, plus généralement, les pays riverains de la Baltique ont un sentiment de vulnérabilité ancré dans une longue histoire de conflits. Pour Peter Zeihan, la menace est plus large encore, parce que la Russie ne se sentirait en sécurité que lorsqu’elle sera en mesure d’adosser ses frontières occidentales à un obstacle naturel. Dans cette logique, elle n’arrêterait son expansion à l’ouest qu’après avoir englouti l’Ukraine, les pays baltes, la Moldavie et une partie de la Pologne et de la Roumanie [5]. Cette vision purement géographique fait fi des leçons de l’histoire. La seule avancée russe profonde et durable vers l’Europe centrale date de 1945, en un temps où des partis communistes affiliés à l’URSS et ne dissimulant pas leur ambition de domination mondiale étaient implantés partout en Europe. Elle a eu lieu dans le cadre d’une guerre contre l’envahisseur allemand, l’URSS étant l’alliée des puissances occidentales, qui lui ont explicitement concédé à Yalta une zone d’influence. Si les États-Unis mirent alors au point un système séduisant de fidélisation de l’Europe occidentale, on ne peut en dire autant de l’URSS, qui eut à gérer, plusieurs fois dans la violence à Berlin, à Budapest, à Prague, le mécontentement de l’Europe centrale et orientale. Une occupation ne bénéficiant pas du contexte de 1945, mais faisant suite à une simple conquête militaire, tournerait rapidement au cauchemar pour les troupes d’occupation. Les dirigeants russes le savent, qui n’ont jamais fait figurer la conquête de l’Ukraine parmi leurs buts de guerre. On n’envahit pas un pays de 40 Millions d’habitants avec un corps expéditionnaire de 190 000 hommes.
Enfin, la Russie n’a pas encore réussi, après trois ans de guerre, à occuper la totalité des trois oblasts du Donbass qu’elle a annexés. A ce rythme de progression, il lui faudrait quelques décennies pour atteindre Paris. Quant à l’arme atomique russe, elle existe, et a été souvent évoquée par les dirigeants de la Russie dans la période récente, mais toujours pour rappeler sa doctrine défensive : une première frappe est possible seulement si les intérêts vitaux de la Russie sont menacés.
Promouvoir le fédéralisme européen
Cette « menace russe », c’est en réalité le nouveau carburant du projet fédéraliste européen, dont le moteur, après le marché unique, le projet de constitution européenne, l’euro et la lutte contre le COVID, est désormais la défense européenne. L’Europe semble avoir adopté un mode de pensée magique. On l’a vu avec l’euro doté de mystérieuses vertus de convergence politique, ou encore avec la « décision» de la COP 21 de limiter à 1,5° l’augmentation de la température terrestre, et on le voit aujourd’hui avec la « menace russe ». Il faut que cette menace existe et, puisqu’elle existe, il faut la combattre préventivement. Ainsi a -t-on pu, comme dans l’Algérie de 1991 quand les islamistes étaient aux portes du pouvoir, annuler un scrutin présidentiel en Roumanie au seul motif que le candidat arrivé en tête du premier tour avait bénéficié d’une efficace campagne sur Tik-Tok, soupçonnée d’avoir été organisée par la Russie. Les auteurs de ce coup d’État croyaient-ils sérieusement avoir été « agressés sur Tik-Tok » ou bien ont-ils plutôt découvert que « la menace russe » est aussi une arme tous terrains de politique intérieure ?
Si la pensée magique a sans doute des vertus de propagande et de mobilisation, elle a l’inconvénient de n’avoir aucun impact sur la réalité. L’exemple le plus spectaculaire demeure le pacte Briand-Kellog, par lequel ses signataires, parmi lesquels on trouvait l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis, avaient, en 1928, déclaré la guerre hors-la-loi. L’élargissement de l’OTAN à la fin du XXe siècle relève d’une logique comparable : on a cru pouvoir, par une formule magique, faire passer à l’ouest (rattacher à l’Atlantique Nord) quatorze pays d’Europe orientale. Ce faisant, on a nié la singularité de la situation géopolitique et plus encore psychopolitique de ces pays, en postulant leur adhésion pleine et entière aux valeurs atlantiques du libéralisme (jusqu’à l’ouverture incontrôlée des frontières à l’immigration), de l’individualisme (jusqu’à la « fluidité sexuelle »), de la démocratie représentative et du pluralisme politique.
Ces pays étant entrés dans l’OTAN, la question de leur relation avec le grand voisin russe était réglée. La Russie protestait, arguant qu’une coalition adverse s’avançait ainsi jusqu’à ses frontières, chose que n’auraient jamais toléré les États-Unis, mais nul besoin de s’en soucier : elle avait perdu la guerre froide, Vae victis ! Seulement, l’immense Russie n’a pas disparu, et elle ne veut pas être « contenue », c’est-à-dire étouffée. Les relations internationales obéissent à une sorte de loi de la gravité : les grands États, ceux que Samuel Huntington appelle « les États-phares », rayonnent économiquement, culturellement. Ils attirent les plus petits dans leur orbite à proportion de leur puissance, de leur proximité et aussi, naturellement, de leurs affinités. Une zone d’influence n’est pas nécessairement synonyme de coercition – elle traduit un certain équilibre régional de la puissance, qui implique des arrangements de sécurité. La neutralité peut-être l’un d’eux. Mais autant se faire une raison : l’ours russe continuera à s’ébrouer tant qu’on cherchera à l’encager.
La loi de la gravité est ici une métaphore. Il faut y adjoindre celle de la tectonique de plaques. Les blocs s’effondrent, comme le soviétique en 1990, ou se fissurent, comme l’occidental sous nos yeux. Il y a des ébranlements soudains, mais aussi des répliques : après la disparition soudaine et presque pacifique de l’URSS, il y a eu la guerre en Géorgie, au Karabakh, en Ukraine. L’équilibre des zones d’influence est alors rompu, et un nouvel équilibre ne peut être atteint que par la guerre ou la diplomatie. En tout cas pas par des formules magiques.
[1] Groupe auquel on peut rattacher la Moldavie du fait d’une république sécessionniste pro-Moscou, la Transnistrie.
[2] Sofi Oksanen, Purge, Stock 2010. Prix Femina étranger
[3] Cf Modeste Schwartz : Mais qui sont ces « nazis » de Bavière ? https://modesteschwartz.substack.com/p/eab-46-mais-qui-sont-ces-nazis-de?r=10v1d0
[4] Cf Alain Antil, François Giovalucchi, Thierry Vircoulon Le discours antifrançais en Afrique francophone. Etudes Aout 2023.
[5] Peter Zeihan, The end of the world is just the beginning; mapping the collapse of globalization. Harper business 2022