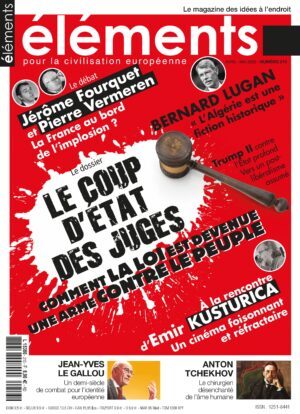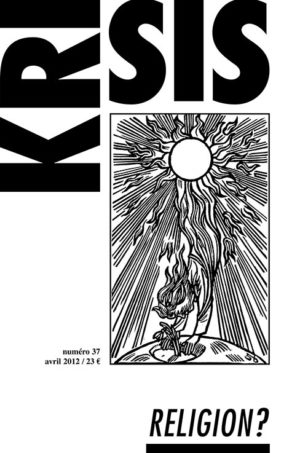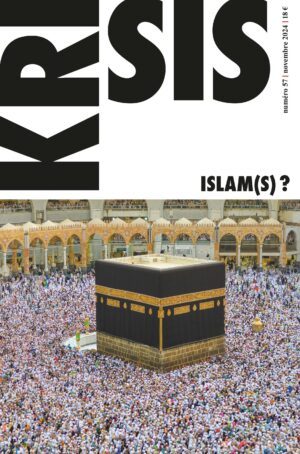Le Vatican a confirmé le décès du souverain pontife ce lundi, succombant à un accident vasculaire cérébral ayant entraîné une insuffisance cardiaque. Quelques heures avant sa mort, le pape avait rencontré le vice-président américain J.D. Vance et avait fait une dernière apparition pour bénir les foules de Pâques à la basilique Saint-Pierre. L’Église se prépare maintenant à l’un des conclaves les plus diversifiés et les plus idéologiquement chargés de l’histoire pour choisir un nouveau Pape. Actuellement, 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans sont habilités à voter pour le prochain occupant du trône de St Pierre. La grande majorité d’entre eux ont été nommés par François lui-même. Dans sa démarche un brin « tiers-mondiste », le défunt Pape a élevé 79 % des cardinaux en âge de voter, dont beaucoup viennent de régions sous-représentées du monde catholique : le « sud global », les petites nations insulaires et les diocèses éloignés qui n’ont jamais été influencés par le Vatican.
« Dans les semaines à venir, 120 des cardinaux ayant le droit de vote entreront dans la chapelle Sixtine pour entamer la tâche solennelle et secrète d’élire le prochain pape. Le conclave doit commencer dans les 20 jours suivant la mort du pontife. Ce sera très intéressant cette fois-ci car, contrairement à ce qui s’est passé dans le passé, je ne pense pas qu’il y ait un successeur évident », déclare Rebecca Rist, professeur d’histoire médiévale à l’université britannique de Reading.
Un pape hostile au vieux continent
Le pontificat de François Ier aura marqué les esprits. Premier Pape jésuite et non européen, et ostensiblement hostile au vieux continent, ses nombreuses interventions auront provoqué la controverse. Sous ses airs débonnaire et populaire, c’est avec une main de fer dans un gant de velours qu’il s’est évertué à exercer son autorité. La curie romaine s’en est d’ailleurs difficilement remise. La caractéristique des démocrates qui, une fois au pouvoir, ne peuvent s’empêcher de faire le vide autour d’eux. Certains catholiques appellent à prendre du recul par rapport à ce qu’ils considèrent comme les bouleversements de ces dernières années. En bon jésuite, nombreuses de ses déclarations se sont révélés plus des exercices de rhétoriques, soufflant le chaud le lundi, pour vite faire retomber le thermomètre le mardi. François a souvent frustré les catholiques conservateurs par son ton pastoral et son programme réformateur. En restreignant la messe traditionnelle en latin et en adoptant une position plus accueillante à l’égard des catholiques LGBTQ et des personnes divorcées, il a adopté une approche qui, selon ses détracteurs, a brouillé les lignes doctrinales et remis en cause des normes établies de longue date. Pour autant, le cardinal Bergolio n’était pas un partisan de l’herméneutique marxiste de la « théologie de la libération[1] » comme il lui a souvent été reproché. Ce dernier mettant en garde contre la tentation d’idéologiser le message évangélique par une «réduction socialisante. »
Un pape Arc-en-ciel ?
« Notre Dieu est peut-être un Dieu de surprises, mais aujourd’hui, j’ai l’impression que nous avons besoin de beaucoup moins de nouveautés, d’intérêts et de surprises, et de beaucoup plus de choses simples, solides et saines », écrit le commentateur catholique Robert Royal dans The Catholic Thing.
D’autres catholiques se sont opposés à l’idée que François soit un « pape progressiste ».
« François était extrêmement traditionnel. Et je pense que c’est un malentendu de dire qu’il n’était pas traditionnel. Rien de ce qu’il a dit ne remet en cause la doctrine », rappelle Phyllis Zagano, professeur adjoint de religion à l’université Hofstra. Il ajoute : « Je pense donc que l’Église, dans sa sagesse, élira un pape qui poursuivra les enseignements de l’Église catholique. Ce qui doit déranger certaines personnes semble-t-il, c’est le sentiment que l’enseignement social catholique est un commentaire politique sur des pays ou des actions spécifiques, alors que l’enseignement social catholique est simplement l’explication de l’Évangile. »
Les prises de position concernant l’immigration du Pape défunt restent le point d’achoppement pour certains, notamment l’administration Trump. En février, le pontife a écrit une lettre aux évêques américains pour excuser les politiques d’immigration de la Maison-Blanche et qualifier les efforts d’expulsion de « crise majeure. »
« L’acte d’expulser des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur propre pays pour des raisons de pauvreté extrême, d’insécurité, d’exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l’environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes, et de familles entières, et les place dans un état de vulnérabilité particulière et sans défense », pouvait on lire dans cette lettre.
Indépendamment des tendances politiques de François, ou de leur absence, certains s’attendent à ce que son successeur ramène l’Église vers le centre idéologique.
« Quel que soit le candidat élu, il sera d’un tempérament centralement conservateur, après 12 ans de « remue-ménage » de la part du pape François », a déclaré Serenhedd James, rédacteur en chef du magazine britannique Catholic Herald. « Je pense que les cardinaux voudront quelqu’un qui adoptera une approche différente et plus calme. »
D’autres estiment que l’Église continuera à suivre la voie idéologique tracée par François.
« L’Église devient plus globale et moins centrée sur Rome qui « dirige » tout », nuance David Gibson, directeur du Centre sur la religion et la culture à l’université Fordham, à Newsweek. « Je pense qu’il est peu probable que l’on obtienne le pape-policier que certains membres de la droite américaine semblent souhaiter. »
Les changements au sein du conclave sont en effet d’ordre géographique. En 2013, lorsque François a été élu, les cardinaux européens représentaient 57 % de l’électorat. Aujourd’hui, ils ne représentent plus que 39 %. L’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie n’ont cessé de gagner en influence. Cette évolution pourrait ralentir le prochain conclave.
« Il est possible qu’un grand nombre des hommes qui se réuniront pour élire le prochain pape soient des étrangers les uns pour les autres », précisait le site d’informations catholique The Pillar l’an passé.
Des candidats se démarquent
Plusieurs candidats de premier plan ont émergé des ailes progressistes et traditionalistes de l’Église. Parmi ces derniers, figure le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines, 67 ans, théologien et ancien fonctionnaire du Vatican souvent décrit comme le « pape François asiatique. » Ce dernier a appelé à une Église catholique plus inclusive et a parlé ouvertement de la nécessité d’accueillir les catholiques divorcés et LGBTQ. Son élection constituerait la première papauté asiatique. Le cardinal français Jean-Marc Aveline, 66 ans, est également en lice. Il serait le cardinal « préféré » de François pour lui succéder. L’analyste du Vatican Giuseppe Masciullo a déclaré que le cardinal Aveline « est particulièrement apprécié » dans les camps ecclésiastiques et politiques de gauche et qu’il soutient une « forte décentralisation » de l’Église, selon le New York Post.
Dans le camp conservateur, c’est bien sûr cardinal Robert Sarah, 78 ans, originaire de Guinée, qui se démarque. Énergique partisan de la tradition, il a appelé à un retour à la messe en latin et a vigoureusement critiqué ce qu’il considère comme une dérive théologique sous le pape François.
Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu du Congo, 65 ans, est également considéré comme un candidat conservateur. Il dirige le Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar et s’est aussi avéré être un grand critique de la décision du Vatican d’autoriser les bénédictions homosexuelles.
Le cardinal italien Pietro Parolin, 70 ans, secrétaire d’État du Vatican, représente l’establishment centriste. Il est considéré comme un candidat de continuité qui pourrait atténuer l’audace de François tout en conservant son héritage en matière de politique étrangère. Un candidat « en même temps » pouvant faire la différence, histoire de calmer tout ce petit monde, s’inscrivant dans la continuité du défunt Pape.
Parmi les autres noms en lice figurent le cardinal italien Matteo Zuppi, un confident de François connu pour avoir mené des pourparlers de paix en Ukraine ; le cardinal hongrois Peter Erdo, un intellectuel rigide sur le plan doctrinal ; le cardinal sri-lankais Malcolm Ranjith, qui s’oppose au mariage homosexuel et soutient la liturgie latine ; et le cardinal brésilien Odilo Scherer, un modéré ayant l’expérience des finances du Vatican. Le cardinal Ranjith, 77 ans, archevêque de Colombo, au Sri Lanka, est considéré comme un candidat particulièrement plausible, sa région d’origine connaissant une forte croissance du catholicisme. Un autre candidat, le cardinal Willem Jacobus Eijk, 71 ans, médecin et théologien des Pays-Bas, attire l’attention. Administrateur accompli, il s’oppose à la bénédiction des couples homosexuels et à la « thérapie de genre. »
Même avec des idéologies concurrentes, les cardinaux doivent élire un pape qui sera à la hauteur de l’accessibilité de François, tout en adoucissant peut-être son rythme de changement, un brin soutenu.
« En termes de relations publiques, il ne serait pas bon d’avoir un pontife très distant et royal », a déclaré Mathew Schmalz, professeur d’études religieuses au College of the Holy Cross. « Je m’attends donc à quelqu’un qui soit un homme du peuple (…) mais qui s’engage avec les autres un peu différemment du pape François. Si ce n’est pas le cas, le conclave pourrait durer très longtemps. » Quoi qu’il en soit, l’Église ne devrait pas s’attendre à ce que le prochain pape penche d’un côté ou de l’autre, politiquement parlant.
Dans la marine, on dit : « Dirigez votre propre cap, mais restez dans la flotte. » Il est à parier que c’est cette direction qui ressortira du conclave. A l’intérieur de la chapelle Sixtine, pendant le conclave (du latin « cum clave », qui signifie « avec la clé »), les cardinaux voteront jusqu’à quatre fois par jour. Si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers requise après 30 tours, le vote se resserre. Seuls les deux premiers candidats restent éligibles et les électeurs doivent choisir entre eux jusqu’à ce que l’un d’entre eux obtienne le soutien nécessaire pour devenir le prochain évêque de Rome.
[1] Courant de pensée théologique chrétienne venu d’Amérique latine, suivi d’un mouvement socio-politique, visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d’intolérables conditions de vie. L’expression « théologie de la libération » fut utilisée une première fois par le prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez lors du congrès de Medellín du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), en 1968. Il développa sa pensée dans l’ouvrage Théologie de la libération, paru en 1972, qui est largement considéré comme le point de départ de ce courant. Pour la pratique, l’instrument d’analyse et d’observation utilisé s’inspire du marxisme