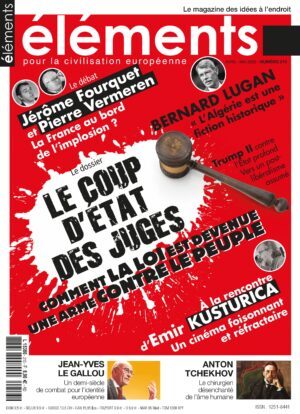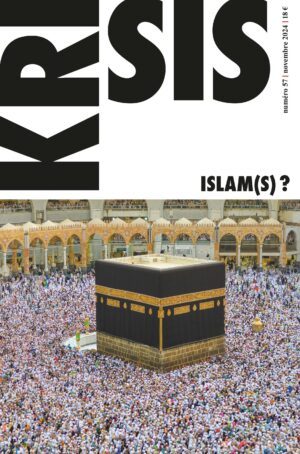Bukowski, c’est un Bartleby destroy. Son adage qui lui servit d’épitaphe Don’t Try, c’est la version simplifiée, donc plus efficace, du I would prefer not to, signature du personnage de Melville, devise de la désobéissance civile, de l’anticonformisme. C’est le Lemmy Killmister de la littérature, ses livres sont des modulations sur un air de God was nerver on your side et de whorehouse blues. Bukowski « Louis-Ferdinand Céline aux petits pieds » dixit François Bousquet. Bukowski, le roi des mange-pas-cher et des boit-sans-soif, le bon pote des putes à bas prix. « J’ai mis mes tripes à nu, et les dieux ont répondu. » disait-il, écho américain de la Célinienne formule – trop souvent reprise à mon goût – : «Il faut mettre sa peau sur la table. Sinon ça pue le gratuit ». Rien ne pue le gratuit chez Bukowski, tout a été cher payé et c’est ce qui le rend si sympathique.
Si vous n’avez jamais dormi la nuit, sur un banc, sous la pluie, cuité et rompu de fatigue par les coups donnés et reçus lors d’une bagarre de circonstance, je suis sceptique sur votre capacité à comprendre vraiment cet auteur, pour être tout à fait franc. Quand je le lis, c’est un peu ma madeleine de Proust, me revient le goût de fer que le sang draine avec lui lorsqu’il se balade dans la bouche, la mâchoire endolorie et la migraine qui l’accompagnent, le sentiment du devoir accompli. Mais enfin, a-t-on besoin de faire la guerre pour lire Voyage au bout de la nuit, d’être membre de l’aristocratie bretonne pour goûter le style de Chateaubriand ou de s’enfiler des seringues dans les back-room après quelques contorsions pas très catholiques, pour apprécier William Burroughs, ou bien de se transformer en machine à écrire carnivore et lascive pour lire le « premier poète de l’âge de la machine » selon le mot de Maurice Dantec ?
Interdit aux fragiles
C’est, aujourd’hui, avec des pincettes et toutes sortes de précautions qu’il convient d’aborder le « vieux dégueulasse ». Les éditions petit à petit ont sorti une bande-dessinée sur sa vie, intitulée De liqueur et d’encre, parue le 21 février 2024, d’assez bonne facture. Ils n’ont pas pu s’empêcher de placer un « avertissement de l’éditeur » en tête de l’ouvrage. Je le reproduis pour les plus fragiles d’entre vous : « Il convient de remettre cet ouvrage dans le contexte de la vie d’un auteur américain du XXe siècle. Ainsi certaines scènes contiennent des attitudes et des propos qui s’apparentent à de la misogynie, de l’hyper sexualisation envers les femmes et de l’homophobie. Nous avons confiance en nos lectrices et nos lecteurs qui sauront identifier et mettre à distance ces passages que nous relatons dans un souci de véracité, sans pour autant les cautionner. » Vous avez compris : avertissement de tantouse pour une époque de châtrés.
Le développement personnel, dans le secteur du livre, représente une part de marché considérable. Flaubert n’a qu’à bien se tenir. Il ne survit qu’à la faveur des prescriptions scolaires, sous perfusion de l’éducation nationale. Je ne plébiscite pas, j’enregistre un état de fait. Force est de constater qu’Anne-Sophie Girard, avec son livre Un esprit bof dans un corps pas ouf met plusieurs milliers d’exemplaires – au bas mot – dans la vue de n’importe quel grand écrivain de notre patrimoine national. Et très étonnamment, c’est un livre de développement personnel qui a contribué à relancer l’intérêt pour Bukowski, un peu oublié, il faut bien le dire, depuis ses frasques sur le plateau d’Apostrophes, qu’on se repasse avec gourmandise pour oublier les Trapenard et autres animateurs télévisuels du néant littéraire contemporain. L’art subtil de s’en foutre, sous-titré un guide pour être soi-même, écrit par Mark Manson, avec la petite pastille noire best-seller du New York Times sur la couverture orange, s’ouvre sur une référence à Bukowski, dont la vie sert de modèle pour ce livre de développement personnel d’un genre nouveau.
Manson, bien malin, ayant flairé l’obsolescence du discours convenu sur la réalisation de soi, la réussite, la psychose à propos de la loi de l’attraction qui n’attire rien du tout, à l’heure du désespoir et du déclassement en Occident, a pondu un livre à l’intention des ratés qui ont vocation, sinon à le rester, du moins à l’assumer. Il leur fallait une icône, un modèle, un champion. Qui de mieux placé que Charles Bukowski, ce vieux dégueulasse, loser magnifique, semi-clochard, nabab au rabais des champs de course, Grand Vizir des coupons de réduction, chantre des poubelles ambulantes, des avinés, des chancelants, des chômeurs longue durée, des gratteurs compulsifs de tickets loto ? Si Nietzsche a pu dire « plus est en nous », Bukowski pourrait dire, avec plus de vraisemblance intérieure : « Plouc est en nous. »
Héraut des déclassés et des perdants
Le livre de Manson s’ouvre, ainsi, sur cette déclaration, contre-pied bien senti à la pensée positive, bien niaise et bien creuse, qui sert de pendant spirituel au tout marketing, au tout-marché et aux tutos make-up : « Charles Bukowski était un alcoolo, un dragueur, un addict au jeu, un mufle, un radin, un parasite et, à son meilleur, un poète. C’est sans doute la dernière personne à qui tu irais demander des tuyaux pour vivre mieux ou qui serait dans un bouquin de développement perso. Je commencerai donc par lui. » Bukowski a lui-même déclaré: « On m’a un jour demandé en quoi consistait ma philosophie de vie, et j’ai dit « n’essaye pas ». C’est aussi valable pour l’écriture. Je n’essaye pas, je ne fais qu’écrire. »
« Le discours ambiant, constate Manson, est saturé jusqu’à l’obsession d’injonctions à positiver. Sois plus heureux. Sois en meilleure santé. Sois le meilleur, meilleur que les autres. Sois plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus populaire, plus productif, toujours plus envié et admiré. Sois parfait, pour ne pas dire exceptionnel, et gagne des fortunes aux jeux en ligne chaque jour que Dieu fait, dès le réveil, sans oublier de rouler une pelle à ta femme accro aux selfies et de claquer la bise à ta progéniture avant de lui souhaiter bonne journée. Envole-toi en hélico vers ton boulot hyper gratifiant où tu passes d’intéressantes journées à sauver la planète. »
Et d’offrir l’auteur de Souvenirs d’un pas grand-chose en contre-exemple : « Bukowski avait des ambitions artistiques. Mais, pendant des décennies, quasiment aucun magazine, aucune revue, aucun journal, aucun agent ni aucun éditeur n’a voulu de sa production. « Abominable, obscène, répugnant », lui rétorquait-on. Assommé par les râteaux à répétition et croulant sous la montagne des lettres de refus, il a sombré dans une profonde dépression, aggravée par l’alcool, qui allait le poursuivre la majeure partie de sa vie.
Il bossait dans un bureau de poste au tri du courrier. Il était payé des clopinettes, dont la quasi-totalité passait dans la boisson. Les quelques sous qui lui restaient, il les claquait sur les champs de course. Le soir venu, il picolait tout seul et, à l’occasion, alignait péniblement quelques vers qu’il tapait sur sa vieille machine à écrire toute pourrie. Il lui arrivait régulièrement de se réveiller par terre après s’être endormi complètement pété.
Trente ans ont passé sur ce registre, dans un halo confus d’alcool, de drogue, de jeux et de putes. Trente années vides de sens. Puis, quand il a atteint la cinquantaine, après des décennies de dégoût de soi à se ramasser des gamelles, le responsable d’une petite maison d’édition indépendante s’est, par un de ces coups du destin, penché sur son cas. L’éditeur en question n’était certes pas en mesure de lui dérouler le tapis rouge ni de lui faire miroiter de grosses ventes. Mais, s’étant entiché du loser imbibé qu’il était, il a fait le choix de lui donner sa chance. C’était bien la première fois que quelqu’un lui faisait vraiment confiance! Avec en tête que ça pouvait aussi bien être la dernière, Bukowski lui a adressé cette réponse : « J’ai deux options: retourner au bureau de poste et devenir dingue… ou ne plus jamais y remettre les pieds, jouer à l’écrivain et crever de faim. J’ai décidé de crever de faim. »
Une popularité tardive
Aussitôt le contrat signé, il s’est mis au travail et a pondu son premier roman en trois semaines. Un texte sobrement intitulé Post Office – traduit en français par Le Postier. « Je dédie ce livre à personne » pouvait-on y lire en lieu et place de la dédicace. Bukowski est parvenu à se faire un nom en tant que romancier et poète. Il a continué d’écrire, publiant six romans et des centaines de poèmes. Ses livres se sont écoulés à plus de deux millions d’exemplaires. Qui aurait pu s’attendre à une telle popularité? Certainement pas lui, en tout cas.
Des histoires telles que celle de Charles Bukowski apportent de l’eau au moulin de notre mythe fondateur. Ce mec incarne le rêve américain: il se bat pour obtenir ce à quoi il aspire, n’abandonne à aucun moment et finit par réaliser ses rêves les plus fous. C’est beau comme l’antique. On est tous babas d’admiration devant des trajectoires comme la sienne, à se dire : « Regarde un peu ce type. Il n’a jamais baissé les bras. Il n’a jamais cessé d’essayer. Il a toujours cru en lui. Il s’est obstiné alors que l’adversité s’acharnait, et il est devenu quelqu’un ! »
À cette aune, son épitaphe « Don’t try » (en français « N’essaie même pas ») – résonne d’autant plus bizarrement. Tu vois ? En dépit des ventes de ses bouquins et de sa célébrité, Bukowski était un loser et il le savait. Ça n’est pas sa farouche détermination à gagner la partie qui a contribué à son succès, mais bien la conscience qu’il avait d’être un perdant, le fait d’y consentir et l’exploitation de cette identité en tant qu’objet d’écriture, en toute honnêteté. Il n’a jamais eu la tentation d’être autre chose que ce qu’il était. Il n’a pas plus essayé de faire mentir tous ceux qui n’avaient pas cru en lui, ni de devenir un génie de la littérature. Bien au contraire. Son génie à lui a simplement consisté dans cet exercice de lucidité sur lui-même – sur sa part d’ombre, surtout-, et dans l’exposition sans réserve, via l’écriture, de ses travers les plus criants.
Telle est l’authentique histoire du succès de Bukowski: être un raté et en prendre son parti. Le succès, au fond, il s’en contrefichait. Devenu une vedette, il continuait de se pointer à des lectures poétiques bourré au dernier degré et d’y invectiver l’auditoire. Il continuait de jouer la provoc et de se jeter sur le premier jupon venu. La notoriété et le succès ne l’ont pas rendu meilleur. Et ce n’est pas davantage en devenant meilleur qu’il a recueilli succès et célébrité. »
Chez Bukowski, il y a un côté authentique ascète – en dépit des hectolitres de bière qu’il ingurgite chaque jour – apologiste du détachement à la Maître Eckhart. C’est aussi un poète d’une grande pureté, auteur de Haïkus ignoré. Un exemple de pure ligne japonaise qu’il exécuta sûrement sur le trône : « fini, plus de papier ». Bukowski est un virtuose du retrait, un reclus monacal sans foi – de l’absence de foi justement. Les pages qu’il noircit sur le monde du travail sonnent si juste qu’on devrait les lire quotidiennement à ces salopes de RH qui trouvent toujours à redire au manque d’enthousiasme du petit salarié sous-payé, condamné à faire des Bullshit jobs toute sa maudite vie. Ainsi, dans Factotum, où sont relatées les pérégrinations et les errances d’Henry Chinaski, l’alter ego de Bukowski, sorte de Bardamu White Trash des bas-fonds américains:
« – Ça va machin, qu’elle me dit, on sait que tu penses que ce boulot n’est pas assez bon pour toi.
- Pas assez bon ?
- Ouais, ça se voit. Tu crois qu’on n’avait pas remarqué ? »
C’est là que j’ai appris pour la première fois qu’il ne suffisait pas de faire son boulot, mais qu’il fallait aussi y trouver de l’intérêt, voire une passion. »
La désagrégation du mode de vie américain
Neeli Cherkovski, ami de l’écrivain et auteur de la biographie qui lui est consacrée, intitulée Bukowski – Une Vie, écrit : « Hank [surnom de Bukowski] perçut la désintégration du mode de vie américain quasiment avant qu’elle débute ». C’était constater qu’il se situait à des années-lumières du Struggle for Life des années Reagan. Virtuose du retrait, disais-je, voici ce qu’il écrit dans son essai décousu sur les règles poétiques et les cruautés de la vie écrit tout en sirotant un pack de six, recueilli dans Un carnet taché de vin , que j’avais déjà reproduit dans un article intitulé Ceux qui ne sont rien : « Ce que je préférais, c’était d’avoir pour moi seul une table en contrebas d’une fenêtre par laquelle les rayons du soleil venaient me réchauffer la nuque, le haut du crâne, les mains, au point que je finissais par penser que tous ces livres avec leurs couvertures rouges, orange, vertes, bleues, si impeccablement rangés sur leurs rayonnages, étaient dépourvus d’intérêt, voire factices. Quoi de plus merveilleux que de sentir le soleil sur sa nuque, que de somnoler, que de rêvasser, sans avoir à se soucier de son loyer, de son ordinaire, de l’Amérique, de ses devoirs de citoyen ? Et pourquoi aurais-je continué à me demander si j’étais ou non un génie puisque je désirais, par-dessus tout, rester en marge de cette société ? L’instinct de conservation, la volonté de puissance dont mes semblables faisaient montre me sidéraient : qu’un homme passât ses journées à changer des pneus ou à parcourir les rues en vendant des ice cream ou à se présenter au Congrès ou à ouvrir le ventre d’un quidam dans une salle d’opération ou au cours d’une rixe, tout cela m’indifférait. Pas question que j’y participasse. Et, par parenthèse, je ne veux toujours pas y participer… Quand une journée s’achevait sans que j’eusse collaboré avec le système, je chantais victoire. »
Nous lui devons un très beau texte sur Antonin Artaud, cette affinité avec un autre « suicidé de la société » n’étonnera pas. Le portrait qu’il dresse d’Artaud est évidemment un autoportrait, un hommage d’âme à âme, témoignage de la confraternité des proscrits : « La violence d’Artaud s’explique par le fait qu’il est l’un des rares Artistes à n’avoir jamais cherché à se mentir et à mentir aux autres. Son implacable lucidité, ses propos incisifs, son dégoût du Mensonge sont à la mesure de la souffrance d’un homme déchiqueté par la Vie et comprenant, non sans une immense répugnance, que ses semblables, les Artistes, ne sont, en fin de compte, que des « cochons ». » Et ne pas se mentir, ça peut commencer par des choses très simples, comme d’admettre que les boulots à la con qu’on se coltine sont des boulots à la con et non des contributions essentielles à la société, encore moins des marchepieds pour atteindre la réussite d’un Elon Musk, et que le développement personnel est une escroquerie qui pourrit, truque et traque les âmes, à la mesure de la vulgarité – la vraie, pas la débonnaire dont nous gratifie notre tendre et raffiné poivrot – de notre époque.
© Photo : Intelligence artificielle – Grok