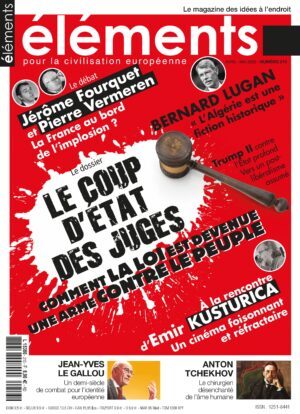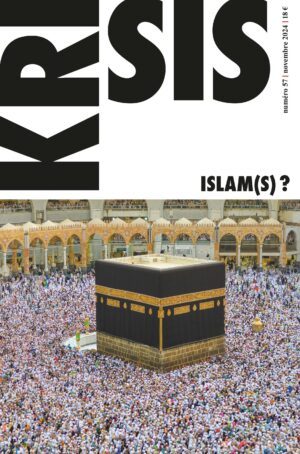Éviter une conflagration générale
La rupture de l’équilibre de la guerre froide aurait nécessité et nécessite encore un nouveau Congrès de Vienne, si l’on veut éviter l’enchaînement des conflits, voire une conflagration générale. Et un nouvel équilibre ne pourra être atteint que par une forme ou une autre d’entente avec la Russie, impliquant non seulement des garanties croisées de sécurité, mais aussi des arrangements économiques pour le développement de la Russie et l’accès de l’Europe aux ressources du sous-sol russe. Mais pour cela, Il faudrait cesser de la traiter comme un État voyou, et comprendre pourquoi elle se prête si facilement au rôle du grand méchant ours [1]. C’est-à-dire prendre en compte non seulement sa situation géopolitique, mais aussi psychopolitique, avec les trois traits principaux qui déterminent sa relation à l’Europe : La Russie est un pays inachevé à l’identité encore incertaine ; c’est un pays orthodoxe ; c’est un ex-pays communiste qui n’a pas été décommunisé.
De Pierre le Grand (1672-1725) à nos jours, les gouvernements russes ou soviétiques ont suivi une même ligne directrice : rattraper l’Occident. Pour Nikita Khrouchtchev, la grande affaire de l’URSS était de « rattraper et dépasser les États-Unis ». En 2025, la Russie est toujours derrière eux, et derrière l’Europe selon tous les indicateurs économiques et de développement. Pour paraphraser une boutade fameuse, l’objectif du rattrapage est à l’ordre du jour et il y restera.
Il est généralement admis que le marasme russe a pour origine, avant même les 70 ans de la glaciation communiste, la brutalité des réformes menées par Pierre le Grand pour européaniser la Russie, et la violente et durable répression du schisme des Vieux croyants, qui s’opposaient à une « catholicisation » de l’orthodoxie par les réformes du patriarche Nikon. La Russie est depuis trois siècles affectée d’une sorte de schisme idéologique permanent entre « les occidentalistes » et « les slavophiles ». Pour mesurer la gravité de l’irritation, il faut se rappeler qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, l’aristocratie ne parlait pas la langue du pays, mais une langue étrangère – le français. Tatiana, l’héroïne d’Eugène Onéguine, le grand poème de Pouchkine, appartient à la petite noblesse de province, mais s’exprime difficilement en russe. L’art russe lui-même porte témoignage d’un déracinement intérieur. La haute culture – St Pétersbourg construite par des architectes italiens, la peinture de Serov, la musique de Tchaïkovski, la littérature de Tolstoï – est entièrement européenne. Elle ne féconde ni n’est fécondée par une culture populaire qui – aussi bien dans son formatage soviétique que dans les séries télévisées contemporaines – se contente de reprendre des stéréotypes occidentaux. Le cinéma russe infirme sans doute cette proposition, mais il n’a jamais créé un univers mythologique comparable au rêve américain usiné dans les studios de Hollywood. Et quand Mac Donald’s a dû quitter le pays à la suite des sanctions, les nouveaux dirigeants de la chaîne, incapables de lui trouver un nom qui sonne russe comme Macdo sonne yankee, l’ont platement rebaptisée « C’est bon, et point [à la ligne] » [2].
L’hémisphère slavophile du cerveau russe a du mal à rendre visible et attractive la synthèse slavo-byzantino-tatare qu’il prétend incarner. Il se définit surtout par son opposition à l’Occident décadent. L’hémisphère occidentaliste souffre d’un complexe d’infériorité, même si ce dernier peut facilement se retourner en arrogance : vouloir rattraper un modèle, c’est se reconnaître inférieur à lui. Il y a une vision commune aux élites russes et occidentales, pour lesquelles la Russie est essentiellement un pays de moujiks attardés. De fait, la comparaison entre les deux ailes collatérales de l’Europe, l’américaine et la russe, qui ont pris leur essor à peu près en même temps au XVIIIe siècle, n’est pas à l’avantage de la Russie. Une géographie infiniment moins favorable que celle des Etats-Unis [3], des héritages historiques très différents – d’un côté la Renaissance, la réforme, le parlementarisme, de l’autre l’invasion mongole, l’orthodoxie et l’autocratie – les ont placés sur des trajectoires divergentes.
Démocratie autoritaire vs démocratie libérale
La démocratie autoritaire qui prévaut en Russie découle de la géographie et de l’histoire de ce pays. Et si elle doit être remplacée, ce ne sera certainement pas par une démocratie libérale à l’occidentale. Les Occidentaux considèrent que leur système de démocratie libérale, aussi malade soit-il, est le meilleur au monde et le seul légitime. Ils trouvent partout, y compris en Russie, des élites urbaines, d’ailleurs souvent soutenues par eux, pour défendre ce point de vue. Il n’en est pas moins faux. Vladimir Poutine n’est ni plus ni moins démocrate aujourd’hui qu’il ne l’était il y a vingt ans, quand il était convié aux réunions du G8. Mais la construction de l’ennemi russe exige de voir en lui un tyran, et chacun sait que les tyrans ont besoin d’aventures militaires pour se relégitimer.
C’est dans l’espace religieux qu’on trouve un art spécifiquement russe. L’irréductible singularité de la Russie, c’est l’orthodoxie. Et elle ne constitue pas vraiment un facteur de rapprochement avec l’Europe fille du catholicisme et du protestantisme. L’orthodoxie, c’est la voie droite du premier christianisme, celui des églises orientales, avant sa translation dans l’occident européen. Les orthodoxes ne reconnaissent aucune universalité, aucune supériorité au christianisme occidental. Ils ont même toutes les raisons de s’en méfier. Le catholicisme, autrement dit l’Occident, c’est, pour les orthodoxes, le coup de force des évêques de Rome qui ont prétendu s’élever à la dignité pontificale, c’est-à-dire impériale. C’est une série d’agressions contre leur civilisation, entamées en 1204 par le sac de Constantinople. L’Occident a pudiquement rangé dans un coin de sa mémoire ces trois jours pendant lesquels les Croisés ont massacré, violé, pillé, détruit la plus grande ville chrétienne, la plus civilisée de ce temps. Les chroniques évoquent des flots de sang dans la ville. Au bout de cette orgie de violence, une grande partie des témoignages de la civilisation antique et byzantine, manuscrits, œuvres d’art, monuments avait disparu. Huit siècles plus tard, en 2004, Jean-Paul II a présenté les excuses de l’église catholique pour cet acte de barbarie.
Les Russes ont eu d’autres occasions de se convaincre que l’esprit de croisade est inhérent à l’occident et qu’ils en seront toujours la cible. Ils gardent la mémoire des croisades suédoises du 13e siècle, et surtout de celle des chevaliers teutoniques, ordonnée en 1242 par le pape Grégoire IX et repoussée par Alexandre Nevski. Mais l’habitude des Occidentaux de venir agresser la Russie pour une juste cause ne s’est pas perdue, puisqu’en 1812 la Grande armée de Napoléon, puis en 1853 une coalition fanco-britannique, sont entrés en territoire russe. La croisade peut se définir comme l’attaque d’un pays lointain, avec lequel l’assaillant n’a pas de relations particulières, au nom d’idéaux supérieurs ; c’est un trait permanent de l’Occident, dont le dernier avatar fut l’invasion américaine de l’Irak. Aux yeux des Russes, l’ingérence de l’Occident dans le conflit russo-ukrainien au nom de ses valeurs s’inscrit dans cette continuité. Pour eux, l’agresseur ontologique dont il faut se méfier, ce n’est pas lui, c’est l’Occident.
Deux évènements ont dominé le XXe siècle russe : la prise de pouvoir communiste et la Seconde Guerre mondiale. Le communisme russe ne le cède en rien à l’hitlérisme par l’ampleur de ses crimes et de ses atteintes à la dignité humaine. Cette vérité a été longtemps occultée, en Russie et ailleurs, par la circonstance décisive que l’Allemagne nazie a perdu la guerre et que l’URSS l’a gagnée. Il s’en est suivi que l’Allemagne a été dénazifiée, qu’elle s’est reconnue coupable des crimes du nazisme, qu’elle considère la Seconde Guerre mondiale comme la pire catastrophe de son histoire, qu’elle en assume la responsabilité et qu’ainsi, en quelques années, la page a été tournée.
Rien de tel en URSS, puis en Russie. Le communisme a survécu à la guerre mondiale. Nikita Khrouchtchev, en reconnaissant discrètement les crimes du stalinisme, les a imputés à un seul homme, se gardant bien de dénoncer et de décrire un système d’oppression qui avait eu des millions de collaborateurs. Quand l’Allemagne a connu la honte, l’URSS a connu la fierté de la victoire. Une victoire obtenue par le maréchal Staline grâce au sacrifice héroïque du peuple soviétique, mais aussi au formidable effort d’industrialisation du pays avant-guerre sous la direction, certes un peu ferme, du PCUS. Ce dernier s’est ainsi relégitimé, se dispensant de toute remise en question. Quand celle-ci a fini par poindre dans les années 1980, l’URSS s’est effondrée dans ce que Vladimir Poutine a nommé « la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle ».
Cette formule, qui suscite des ricanements en Occident, est parfaitement admise par nombre de Russes qui ont vécu la catastrophe économique et sociale, l’humiliation nationale et personnelle des années 1990. La Russie s’est relevée au début du XXIe siècle. Le sacrifice du peuple russe pendant la seconde guerre mondiale et la victoire de 1945 sont alors devenus le mythe fondateur de la fierté nationale retrouvée. Que la victoire a été obtenue malgré l’inefficacité militaire initiale du régime, responsable de la déroute de 1941, est une vérité interdite. Pas question d’une (auto)-critique du communisme, ni même de la terreur stalinienne, car elle écornerait le mythe et risquerait de diviser une société qui sait qu’une moitié de ses grands-parents a envoyé l’autre au Goulag. La grande avenue de la plupart des villes russes s’appelle toujours Lénine, et la statue du chauve au manteau soulevé par l’élan révolutionnaire trône toujours sur la place principale, faisant de la Russie le seul pays issu de l’URSS à n’avoir pas effacé les traces du communisme dans le paysage urbain. Comment ne pas se méfier d’un pays qui refuse de regarder en face les crimes qui ont frappé son peuple et les autres peuples de l’empire soviétique, et d’un gouvernement qui s’oppose à leur évocation? [4]
Sortir de la logique de la confrontation
Ce n’est pas le règlement de comptes russo-ukrainien, mais le nouage de ces trois fils de malentendus et de méfiance qui constitue l’ennemi russe, et qui nous conduit vers la guerre. Pour inverser cette pente, il faudrait d’abord vouloir sortir de la logique de la confrontation, ce qui ne semble pas être la préoccupation de la plupart des dirigeants européens. On a le sentiment que le néo-conservatisme américain, aujourd’hui mis à l’écart par Donald Trump, a trouvé refuge en Europe. Pour cette école de pensée, la Russie a été définitivement ébranlée par la disparition de l’URSS. Sa démographie déclinante, l’irrédentisme potentiel de ses périphéries musulmanes, la corruption inexpugnable de ses élites qui rejaillit sur l’efficacité de son armée et de son économie, sont autant d’atouts pour pousser l’avantage et mettre définitivement à genoux l’encombrant mastodonte.
Une approche plus réaliste, en tout cas moins dangereuse, serait d’accepter la Russie et de chercher la voie de la coopération avec elle. Pour s’y engager, il faudrait changer notre regard, voir en elle non plus un moujik attardé mais au contraire un pays de pionniers, avec les qualités et les défauts que cela implique, reconnaître et cultiver sa proximité avec l’Europe et accepter en même temps son altérité. On pourrait alors commencer à défaire le nœud de défiances et d’incompréhensions. Guérir une névrose, c’est rompre avec la fatalité des répétitions : des autolimitations et des échecs dans le cas des individus, des préjugés, des rancunes, des paranoïas nationalistes dans le cas des nations.
Il faudrait d’abord visiter les morts. Comme nous ne croyons plus aux fantômes, nous ne comprenons pas, nous sommes même choqués, quand les Russes aperçoivent des nazis en Ukraine. Ce sont pourtant bien eux, les fantômes de la Seconde Guerre mondiale, qui, de Lviv à Tallin, ravivent des plaies qu’on croyait cicatrisées. Et ce sont les morts de la Grande guerre patriotique que la Russie invoque le 9 mai pour affirmer sa grandeur avec autant d’emphase nationaliste. 27 millions de Russes – un sur six – ont payé de leur vie la victoire du 9 mai 1945. Ils ont cassé la Wehrmacht (85% de ses pertes sur le front est) et anéanti la machine de guerre nazie. En faisant mine d’ignorer l’ampleur de ce sacrifice, en affectant de célébrer le D.Day et d’oublier Stalingrad, nous offensons leur mémoire et celle de leurs descendants.
Il faut aller à Moscou leur rendre hommage le 9 mai. Cette marque de respect et de gratitude, sans considération des aléas de la politique contemporaine, toucherait les cœurs russes. Elle permettrait d’affirmer aussi que le culte des morts ne peut être hémiplégique, que la mémoire des victimes du Goulag est aussi indispensable que celle des héros de la guerre. Avec ce « dégel de la mémoire », le fantôme de Staline, dernière incarnation de la grandeur russe, ne serait plus utile. Et il serait alors possible de convenir avec les Baltes et les Ukrainiens que la haine du régime d’oppression bolchevique était légitime et, en même temps, qu’elle a conduit les mouvements nationalistes à s’associer au nazisme et trop souvent à ses crimes. Le « en même temps » est futile dans la vie politique, mais, dans les cimetières, il signifie la possibilité du pardon et de la réconciliation. Les orgueilleuses statues de Lénine ou de Bandera pourraient être envoyées au musée.
Ayant réglé leurs affaires avec les morts, les vivants pourraient enfin réunir le nouveau congrès de Vienne qui déterminera les compromis et les coopérations d’une architecture de sécurité de l’Europe et de la Russie, afin de leur assurer un siècle à peu près sans guerre, comme l’avait fait celui de 1815.
Tout cela relève bien sûr du rêve. Trop de sang a déjà coulé en Ukraine, et l’Europe semble bien décidée à continuer cette guerre jusqu’au dernier Ukrainien. Les puissances qui regardent le massacre d’un peu plus loin n’ont aucun intérêt à une réconciliation de l’Europe et de la Russie. La manœuvre engagée par Donald Trump pour tenter de casser l’alliance russo-chinoise n’implique nullement un rapprochement de la Russie et de l’Europe, dont son projet d’accord avec l’Ukraine sur les matières premières ne tient aucun compte.
Il faut pourtant continuer à rêver. Pour refuser la guerre vers laquelle nous entraînent les « somnambules » d’aujourd’hui, mais aussi parce que c’est la pire des stupidités que d’interdire à l’Europe de s’inventer un futur commun avec son voisin oriental, qui se trouve être un géant malcommode, mais doté d’une colossale réserve d’énergie, et pas seulement dans son sous-sol. Vladislas Sourkov, le « Mage du kremlin », annonce l’émergence d’un « Nord global »[5]. Quant à Arnold Spengler, dans son Déclin de l’Occident, il voyait poindre, après la fin du cycle occidental au XXIe siècle, un millénaire russe. Il n’est pas besoin de si grandioses prophéties pour choisir la voie de l’entente avec la Russie comme celle de la paix et de la prospérité partagée.
[1] Mikhail Saakashvili, ancien président de la Géorgie, de mémoire : « Pendant ma présidence, j’ai appris deux choses : il n’y a pas de repas gratuit et il n’y a pas de Russie gentille. »
[2] Cf Modeste Schwartz : Vkousno i totchka – Géopolitique du Hamburger. https://modesteschwartz.substack.com/p/vkousno-i-totchka-ou-mcdonalds-geopolitique?r=10v1d0
[3] cf Peter Zeihan, op.cit.
[4] L’association Memorial a été interdite en 2021
[5] Cf. Modeste Schwartz : Vers des retrouvailles de l’Occident et de la Russie ?
Première partie
Psychopolitique de la menace russe (1)