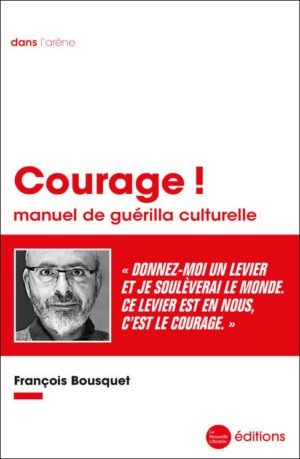Il n’y a jamais eu aussi peu de raisons de parler de révolution qu’au long des années 1960-1970. La seule révolution qui était en train de gangrener et pourir la planète, c’est celle de la consommation de masse et de l’hédonisme. « Révolution » n’a du reste ici aucun sens et passe à côté de la nouveauté du phénomène, tant et si bien que Pasolini préfère parler dans ses Écrits corsaires de « cataclysme anthropologique » ou encore de « mutation anthropologique », comme lors du passage d’Homo erectus à Homo sapiens, mais aujourd’hui en sens inverse.
Cela n’a surpris que ses lecteurs superficiels, mais le fait est qu’il a pris parti en 68 pour les policiers (issus du monde ouvrier et paysan) contre les étudiants et autres « fils à papa ». La « révolution » étudiante lui semblait ne porter aucune revendication sociale. C’était une révolte générationnelle, une sortie agitée de l’adolescence, beaucoup plus proche du grand concert rock que de l’insurrection ouvrière. Première révolution sans ouvriers, sans pauvres, sans morts.
La contestation a finalement renforcé le processus de normalisation. La fonction des étudiants ayant consisté à désacraliser l’autorité des vieux mondes. À partir de quoi, la société de consommation a pu se déployer à son aise, sur la tabula rasa du passé, sans les interdits qui la bridaient jusque-là. La mise au jugement du passé et le procès des pères s’apparentent donc à une crise de croissance de la bourgeoisie. Les nouvelles générations de bourgeois se révoltaient contre la paléo-bourgeoisie patriarcale, fondamentalement inadaptée aux nouvelles conditions de vie, aux progrès technologiques et à la révolution des modes de production et de consommation. Avec le recul, la greffe de la contre-culture sur une culture bourgeoise délestée de son paternalisme (rendu inutile par la mécanisation et bientôt la délocalisation de la production) le prouve abondamment : mariage des hippies et des yuppies, des libéraux et des libertaires, des actionnaires et des révolutionnaires, pour aboutir à cette figure éminemment moliéresque : le bourgeois-bohème.
Quand la loi ne contraint plus le désir
Le règne de la consommation rend inutile l’antique prestige de la religion. La consommation est magique, dans son abondance et dans sa prodigalité. Elle tient de la manne céleste et de la multiplication des pains. Quel dieu peut bien offrir un paradis aussi tangible ? C’est bien l’idolâtrie de notre époque. La consommation a homogénéisé les différences de classe en identiques réflexes d’acquisition. Ainsi posés à plat, les traditions culturelles cédaient leur hétéronomie en échange d’un droit d’accès à la société d’abondance. L’individualisme n’étant plus que la faculté d’accomplir sous tous les fuseaux horaires et selon une logique prévisible et donc facilement instrumentalisable le geste toujours semblable de l’acquéreur, sous l’apparence de différenciations marginales que la mode concède.
Grâce aux bons offices du gauchisme, le capitalisme a ainsi pu effacer les médiations du désir. L’accès à la jouissance s’en est trouvé désinhibé. Freud a mis à notre disposition un discours et des concepts particulièrement éclairants pour déchiffrer un tel mécanisme. Jusque-là, les sociétés fonctionnaient sur la culpabilité, la mauvaise conscience, le sentiment de honte individuelle, qui rendaient déshonorants toute une série de comportements. Le « Surmoi », en termes freudiens, encadrait le « Ça » ; la loi contraignait le désir.
Telle était encore la société (jusqu’aux années cinquante) qui a vu naître Pasolini : bourgeoise, pharisienne, cléricale et fasciste. Société tout à fait disposée au lynchage d’un homme comme lui. « Je regarde avec un œil sage/ comme une image les préposés au lynchage./ J’observe mon propre massacre avec le tranquille/ courage du savant… » Il pouvait se comparer à bon droit aux Noirs américains et s’en tenir au racisme primaire de la société italienne à son encontre. C’est d’une certaine façon le dernier condamné à mort, juste avant l’abolition de la peine de mort et l’avènement de la libération sexuelle. Peu d’auteurs ont été autant poursuivis et condamnés que lui, mais ce harcèlement judiciaire et moral préludait à la levée de tous les interdits. On était en train de passer de sociétés répressives à des sociétés jouissives.
« Je me suis complètement fourvoyé »
Parce qu’il mesurait la sexualité à l’aune de son homosexualité, il a très largement surévalué le sexe. Prenant la partie pour le tout, il a péché par métonymie. Peu avant sa mort, il l’avouait d’ailleurs sans détour : la fonction a chez lui hypertrophié l’organe. Quoiqu’il revienne constamment à l’œuvre de Freud, force est de constater qu’il semble avoir surtout subi l’ascendant du pansexualisme de Wilhelm Reich, à bien des égards l’anti-Freud. Théorème, sorti en salle en 1968, est sans équivoque un Christ reichien, grand libérateur sexuel qui aurait lu Rimbaud plutôt que le prophète Jérémie.
Voulant échapper à la malédiction de l’histoire et du péché originel, Pasolini a succombé au rêve d’un monde inconditionné, auto-engendré, sans filiation, sans dettes. Il s’est trompé autant qu’on pouvait se tromper, massivement, coupablement. Avec un zèle apostolique et un souci d’évangéliser qui aggravent son cas. « Je me suis complètement fourvoyé », ainsi commence son cycle de Poésie en forme de rose. Il le dira et le redira partout ailleurs, comme un remords de conscience lancinant. Ayant voulu arracher le sexe à la Loi, il lui a donné (au seul sexe de l’homme) des pouvoirs thaumaturgiques. Le miracle est particulièrement visible dans la Trilogie de la vie. Quand on passe de la Trilogie de la vie à son dernier film, Salò ou les cent vingt journées de Sodome, il y a comme une sorte de révolution copernicienne, sans droit de suite. De soleil, le sexe devient astre noir. D’Éros, on passe à Thanatos, force obscure, destructrice et mortifère. Salò est le testament cinématographique par défaut du poète, dernier acte d’une longue série d’abjurations.
Il n’y a pas de libération sexuelle. On peut seulement se libérer des illusions de la libération sexuelle, sinon de la libération elle-même, sauf à encourir le risque de sa violence. Pasolini a fait une expérience qui a manqué à sa génération intellectuelle. Il est descendu dans les soutes de la société et y a entraperçu un monstre en train de se dessiner : l’embryon naissant de la « nouvelle jeunesse » (à qui il s’adresse dans ses Lettres luthériennes), celle qui est née avec la société de consommation et n’a connu que le désir sans censure et la violence sans langage, préfigurant par son conformisme agressif et sa claustration inexorable le monde de demain.
Descendre aux enfers
C’est dans Médée que la nostalgie pasolinienne « du mythique, de l’épique et du sacré » est la plus visible et c’est dans Médée qu’il nous livre sa conception la plus achevée de la violence. La pièce d’Euripide n’est qu’un prétexte pour révéler ce qui sépare deux mondes antagoniques : l’archaïque et le moderne. Dans l’un, la violence est sacrée et rituelle ; dans l’autre, elle est indifféremment nihiliste, sadique et fonctionnelle. C’est dans ce monde déjà désenchanté – en dernière analyse bourgeois – que la nouvelle jeunesse annonce les traits de la nouvelle société que Pasolini entrevoit. Il l’entrevoit à travers la déchéance de l’ancien voyou, ce jeune garçon des faubourgs des villes encore préindustrielles, le raggazo di vita, dont il a été l’ultime ethnographe. À travers lui et dans l’intervalle qui va des années cinquante aux années soixante-dix, Pasolini a assisté à la liquidation du monde antique du Caravage et d’Accatone, chassé au profit des marques et des nouveaux uniformes de la rébellion. La société de consommation est un pénitencier. « Les personnages principaux de ce pénitencier sont les jeunes. » Lesquels disent à cette société son échec complet à les insérer dans un avenir commun et donc dans tout avenir.
Pasolini prévenait dans son dernier entretien : « Je ne mâcherai pas mes mots : moi, je descends en enfer, et je sais des choses qui semblent ne pas troubler votre quiétude. Mais prenez garde. L’enfer monte chez vous aussi. […]. Il ne restera plus très longtemps la seule expérience intime et risquée de qui a goûté, comment dire, à la “vie violente”. Ne vous faites pas d’illusion. »
Il y a un thème qui revient souvent, dans Accatone, au début des Anges distraits, dans les poèmes, c’est qu’il est mort, qu’il regarde de l’autre côté du miroir, à l’extrémité du tunnel. D’où assurément l’intensité de sa double vision. Dans La Divine mimésis, il dit de l’« auteur », lui en l’occurrence, qu’il « a été tué à coups de bâton l’an dernier à Palerme. » Pasolini ne pouvait pas se suicider (il y a songé au moment de la fuite à Rome, en 1949, quand il était poursuivi pour corruption de mineurs), il ne pouvait qu’être tué. Il a voulu mourir, mais de la main des dieux, comme un héros mythologique, parce que le mythe est à ses yeux le seul réel qui compte. Dans son être profond, Pasolini appartient au mythocosme. C’est un héros d’un autre temps et d’une réalité que les modernes ont perdue. Il croit à l’action dramatique de la mort. La mort est le début de la vie du mythe. Il écrit dans L’Expérience hérétique, à propos de l’assassinat de Kennedy : « La mort accomplit un fulgurant montage de notre vie […]. Ce n’est que grâce à la mort que notre vie nous sert à nous exprimer. »
Orphée immolé
La mise à mort de Pasolini, survenue dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur une plage d’Ostie, nous révèle ce qu’on pressentait déjà, le souverainement humain et le monstrueusement inhumain de ce destin, au sens nietzschéen du mot. Il faut relire froidement le rapport d’autopsie. La scène rappelle par sa liturgie macabre la grande messe noire de Salò ou les cent vingt journées de Sodome : « Les doigts de la main gauche coupés et fracturés. La mâchoire gauche brisée. L’oreille droite à moitié coupée, la gauche complètement arrachée. Des blessures sur les épaules, la poitrine : avec les marques de pneus de sa voiture… Entre le cou et la nuque, une horrible lacération. Aux testicules, une ecchymose large et profonde. Dix côtes brisées, ainsi que le sternum, le foie lacéré en deux points, le cœur lacéré… »
Pier Paolo Pasolini est mort comme il a vécu. En demi-dieu. Livré au massacre de l’opinion publique, avec la complicité de dieux jaloux, déchiqueté par des furies, dépecé par des ménades. Orphée immolé, dont le chant n’est pas prêt de s’éteindre, qui étreint le cœur et fait serrer le poing des hommes. Les demi-dieux sont certes mortels, mais ils n’en continuent pas moins de parler aux survivants. Que disent-ils en dernier ressort ? Si la vitalité est désespérée, le désespoir est vital. Il n’y a pas d’autre façon de s’opposer à l’enfer programmé par le développement, dans des sociétés d’ores et déjà post-humaines, qui se dressent sur les ruines de l’ancien monde des hommes et des bêtes, dans la nuit du sacré.